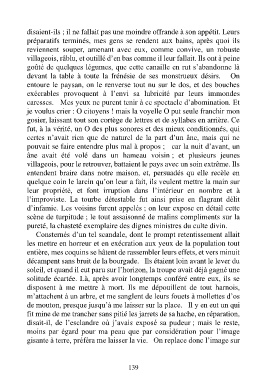Page 139 - L'ane d'Or - auteur : APULEE- Libre de droit
P. 139
disaient-ils ; il ne fallait pas une moindre offrande à son appétit. Leurs
préparatifs terminés, mes gens se rendent aux bains, après quoi ils
reviennent souper, amenant avec eux, comme convive, un robuste
villageois, râblu, et outillé d’en bas comme il leur fallait. Ils ont à peine
goûté de quelques légumes, que cette canaille en rut s’abandonne là
devant la table à toute la frénésie de ses monstrueux désirs. On
entoure le paysan, on le renverse tout nu sur le dos, et des bouches
exécrables provoquent à l’envi sa lubricité par leurs immondes
caresses. Mes yeux ne purent tenir à ce spectacle d’abomination. Et
je voulus crier : O citoyens ! mais la voyelle O put seule franchir mon
gosier, laissant tout son cortège de lettres et de syllabes en arrière. Ce
fut, à la vérité, un O des plus sonores et des mieux conditionnés, qui
certes n’avait rien que de naturel de la part d’un âne, mais qui ne
pouvait se faire entendre plus mal à propos ; car la nuit d’avant, un
âne avait été volé dans un hameau voisin ; et plusieurs jeunes
villageois, pour le retrouver, battaient le pays avec un soin extrême. Ils
entendent braire dans notre maison, et, persuadés qu elle recèle en
quelque coin le larcin qu’on leur a fait, ils veulent mettre la main sur
leur propriété, et font irruption dans l’intérieur en nombre et à
l’improviste. La tourbe détestable fut ainsi prise en flagrant délit
d’infamie. Les voisins furent appelés ; on leur expose en détail cette
scène de turpitude ; le tout assaisonné de malins compliments sur la
pureté, la chasteté exemplaire des dignes ministres du culte divin.
Consternés d’un tel scandale, dont le prompt retentissement allait
les mettre en horreur et en exécration aux yeux de la population tout
entière, mes coquins se hâtent de rassembler leurs effets, et vers minuit
décampent sans bruit de la bourgade. Ils étaient loin avant le lever du
soleil, et quand il eut paru sur l’horizon, la troupe avait déjà gagné une
solitude écartée. Là, après avoir longtemps conféré entre eux, ils se
disposent à me mettre à mort. Ils me dépouillent de tout harnois,
m’attachent à un arbre, et me sanglent de leurs fouets à mollettes d’os
de mouton, presque jusqu’à me laisser sur la place. Il y en eut un qui
fit mine de me trancher sans pitié les jarrets de sa hache, en réparation,
disait-il, de l’esclandre où j’avais exposé sa pudeur ; mais le reste,
moins par égard pour ma peau que par considération pour l’image
gisante à terre, préféra me laisser la vie. On replace donc l’image sur
139