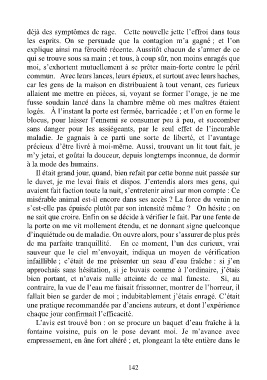Page 142 - L'ane d'Or - auteur : APULEE- Libre de droit
P. 142
déjà des symptômes de rage. Cette nouvelle jette l’effroi dans tous
les esprits. On se persuade que la contagion m’a gagné ; et l’on
explique ainsi ma férocité récente. Aussitôt chacun de s’armer de ce
qui se trouve sous sa main ; et tous, à coup sûr, non moins enragés que
moi, s’exhortent mutuellement à se prêter main-forte contre le péril
commun. Avec leurs lances, leurs épieux, et surtout avec leurs haches,
car les gens de la maison en distribuaient à tout venant, ces furieux
allaient me mettre en pièces, si, voyant se former l’orage, je ne me
fusse soudain lancé dans la chambre même où mes maîtres étaient
logés. À l’instant la porte est fermée, barricadée ; et l’on en forme le
blocus, pour laisser l’ennemi se consumer peu à peu, et succomber
sans danger pour les assiégeants, par le seul effet de l’incurable
maladie. Je gagnais à ce parti une sorte de liberté, et l’avantage
précieux d’être livré à moi-même. Aussi, trouvant un lit tout fait, je
m’y jetai, et goûtai la douceur, depuis longtemps inconnue, de dormir
à la mode des humains.
Il était grand jour, quand, bien refait par cette bonne nuit passée sur
le duvet, je me levai frais et dispos. J’entendis alors mes gens, qui
avaient fait faction toute la nuit, s’entretenir ainsi sur mon compte : Ce
misérable animal est-il encore dans ses accès ? La force du venin ne
s’est-elle pas épuisée plutôt par son intensité même ? On hésite ; on
ne sait que croire. Enfin on se décide à vérifier le fait. Par une fente de
la porte on me vit mollement étendu, et ne donnant signe quelconque
d’inquiétude ou de maladie. On ouvre alors, pour s’assurer de plus près
de ma parfaite tranquillité. En ce moment, l’un des curieux, vrai
sauveur que le ciel m’envoyait, indiqua un moyen de vérification
infaillible ; c’était de me présenter un seau d’eau fraîche : si j’en
approchais sans hésitation, si je buvais comme à l’ordinaire, j’étais
bien portant, et n’avais nulle atteinte de ce mal funeste. Si, au
contraire, la vue de l’eau me faisait frissonner, montrer de l’horreur, il
fallait bien se garder de moi ; indubitablement j’étais enragé. C’était
une pratique recommandée par d’anciens auteurs, et dont l’expérience
chaque jour confirmait l’efficacité.
L’avis est trouvé bon : on se procure un baquet d’eau fraîche à la
fontaine voisine, puis on le pose devant moi. Je m’avance avec
empressement, en âne fort altéré ; et, plongeant la tête entière dans le
142